



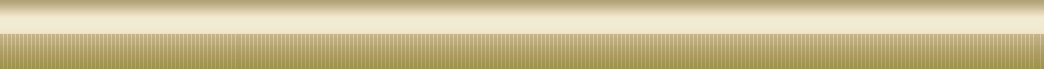

Les Noirs

En France, comme dans le reste des pays européens d’immigration (et ce, y compris dans la littérature scientifique) lorsqu’il est question des « populations noires » présentes sur le territoire national, les termes utilisés sont souvent très imprécis, voire inappropriés. Si beaucoup font l’amalgame entre « Noirs » et « Africains », en considérant ces derniers comme une population homogène, d’autres opèrent une distinction entre « Maghrébins » et « Africains », distillant ainsi l’idée que les Nord-Africains appartiendraient à un autre continent. Parallèlement, d’autres, afin d’éviter toute référence à la couleur de la peau, remplacent le terme « Africains noirs » par celui de « Subsahariens ».
Selon l’avis de certains spécialistes, cette façon de penser serait l’héritage d’une époque coloniale où les populations noires d’Afrique et d’Amérique étaient perçues comme constituant une même catégorie d’assujettis au sein de l’Empire français. Quoi qu’il en soit, elle nécessite d’être rectifiée en vue de faire émerger les différences qui existent entre des personnes et des groupes qui n’ont en commun qu’un phénotype particulier, accompagné de son lot de représentations et de préjugés. Parler en France des « Noirs » signifie d’abord parler d’un large éventail de nationalités, de groupes ethniques (avec leurs cultures) et de régions de provenance. Ensuite, cela suppose d’avoir présent à l’esprit que deux continents d’origine au moins sont concernés : l’Afrique et l’Amérique, dont les histoires coloniales et migratoires sont bien distinctes : si les colonies françaises des Amériques et de La Réunion remontent au XVIIe siècle, la conquête française de l’Afrique s’est effectuée tout au long du XIXe siècle et, dans bien des cas, surtout à l’aube du XXe. Pour les anciennes populations noires des Antilles, de la Guyane et de La Réunion, ce décalage historique comporte, par exemple, le fait d’avoir connu l’esclavage, dont la mémoire pèse encore dans les esprits de nombre de leurs descendants immigrés dans l’Hexagone.
De l’abolition de l’esclavage (1848) à la Première Guerre mondiale (1914)
Par rapport à d’autres pays européens, la présence de « populations noires » sur le territoire de la métropole est plutôt ancienne et devient plus rapidement qu’ailleurs partie prenante du paysage humain national, malgré une certaine tendance de la politique gouvernementale, plus marquée durant l’entre-deux-guerres, à considérer comme problématique l’augmentation des ethnies noires.
En 1870, durant la guerre franco-prussienne, parmi les bataillons de « coloniaux », qui proviennent en grande partie du Maghreb, se trouvent également des « tirailleurs sénégalais » — terme qui, en dépit du nom, désigne les militaires « indigènes » africains de plusieurs pays et quelques « Créoles ». Comme les « tirailleurs algériens », ces soldats sont bien perçus par l’opinion publique française qui les assimile aux braves « Turcos » qui ont combattu les Russes en Crimée (1853-1856), à savoir des troupes coloniales appelées ainsi par l’ennemi qui les avait prises pour des Turcs.
La même année, un décret du 15 septembre, prévoit la nomination de deux représentants, en l’occurrence « noirs », de la Guadeloupe et de la Martinique à l’Assemblée nationale et au Sénat, tandis qu’en 1887 il adviendra de même pour les « quatre communes » sénégalaises de Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufisque.
Inspirée par l’évolutionnisme darwinien, la période qui va de 1860 à la première décennie du XXe siècle voit en Europe l’émergence de théories racistes et polygénistes. Les puissances européennes s’emparent du « continent noir » et les conquêtes ont comme répercussion culturelle une vague d’exotisme qui se manifeste tout particulièrement à l’occasion des différentes « expositions universelles ». Dans ces circonstances, la France, qui en 1889 vient de créer l’Afrique occidentale française (AOF) associée à l’Afrique équatoriale française (AEF), expose à Paris des « villages ethnographiques » de « sauvages » africains à côté de troupes de tirailleurs sénégalais et malgaches. Si ces exhibitions permettent de montrer aux visiteurs l’« action civilisatrice » de l’entreprise coloniale, elles inspirent l’imagination de certains écrivains et dessinateurs qui préfigurent une « invasion noire » et musulmane à laquelle Paris saura faire faceQK.
Au début du XXe siècle, différents comités, gouvernementaux (comme le Comité d’études et de contrôle de la main-d’œuvre immigrée) ou académiques (comme la Commission permanente pour l’étude des métis), se déclarent opposés à l’importation de travailleurs noirs et au métissage des « races ». Pourtant, la France n’interdira jamais les unions entre Français et indigènes, pas plus qu’elle n’empêchera l’arrivée d’individus noirs dans l’Hexagone. Avant 1914, ces derniers sont plus d’un millier, souvent des domestiques arrivés avec leurs riches patrons coloniaux ou bien des étudiants venus surtout de Madagascar, ou encore des Antillais de différents milieux sociaux.
Du début de la Première Guerre mondiale à la fin de la Deuxième
Lors des deux guerres mondiales, face à des troupes allemandes plus nombreuses et mieux équipées, la France, en plus de ses conscrits métropolitains, doit faire appel à ses colonies. Le pays a besoin de soldats, mais aussi de main-d’œuvre pour ses usines d’armement, pour la maintenance de la voirie et pour le fonctionnement de certains services. Les recrutements s’effectuent par le biais de mesures incitatives pouvant aller, notamment pour les soldats indigènes, jusqu’à la promesse de se voir octroyer les mêmes prérogatives civiques que les colonisateurs.
En 1914, alors que la guerre se profile, l’armée française hésite à installer en métropole des divisions noires, mais lorsque le conflit éclate, les tirailleurs sénégalais, malgaches et créoles sont acclamés à leur arrivée en Languedoc-Roussillon. Peu accoutumés au froid des Ardennes et de la Picardie et après des débuts décevants, les soldats de la « force noire », se distinguent par des actions héroïques, comme lors de la défense de Reims en 1917. À l’arrière, un Service de surveillance et d’organisation des travailleurs coloniaux (SOTC) coordonne le travail des « Blancs », des « Noirs » et des « Jaunes », tandis que nombre d’Antillaises sont appelées pour assister les blessés.
Fin 1918, à l’issue de la guerre, les soldats et travailleurs indigènes présents sur le territoire français sont au nombre de 400 000 : mais, faisant fi de ses promesses d’octroi du statut de citoyen français, l’État les rapatrie presque tous manu militari, à l’exception de quelque 21 000.
Durant l’entre-deux-guerres, face au besoin de main-d’œuvre de l’Hexagone, les gouvernements qui se succèdent préfèrent recourir aux travailleurs étrangers plutôt qu’aux coloniaux, qui « présenteraient des risques » sur le plan sanitaire et du métissage. Parallèlement, certains habitants allemands considèrent comme une « honte » d’être surveillés par des soldats noirs appartenant aux garnisons qui occupent la Rhénanie.
Dans les années 1930, les Antillais, les Guyanais et les Réunionnais sont nettement majoritaires parmi les Noirs présents sur le territoire métropolitain. Parmi les Africains, notons la présence d’intellectuels et d’artistes, comme Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Léon-Gontran Damas, Guy Tirolien, Birago Diop et René Depestre, qui promeuvent un mouvement anti-colonialiste et sont à l’origine du courant de pensée dit de la « négritude ».
À l’aube de la Deuxième Guerre mondiale, le scénario du conflit précédent se répète. La France mobilise plus de 80 000 soldats noirs coloniaux : 65 000 tirailleurs sénégalais et 15 000 malgaches, auxquels s’ajoutent quelques créoles. Le traitement des prisonniers opéré par l’armée allemande se révèle très discriminatoire vis-à-vis des soldats noirs, qui sont systématiquement massacrés.
Les « Trente glorieuses »
Dès l’après-guerre, de plus en plus d’Afro-Antillais commencent à s’installer en France. En 1954, on recense 15 000 Guadeloupéens et Martiniquais (surtout des étudiants et des fonctionnaires), 8 600 Guyanais, Réunionnais et ressortissants des TOM, ainsi que 15 000 Africains noirs, concentrés notamment à Paris et à Marseille. Les associations d’étudiants noirs anti-colonialistes se multiplient et se fédèrent autour de la FEANF (Fédération des étudiants d’Afrique noire en France) et parviennent, malgré des répressions policières, à sensibiliser leurs compatriotes en faveur de la décolonisation.
Dans les années 1960, alors que les pays colonisés obtiennent leur indépendance les uns après les autres, une autre ère migratoire commence pour les territoires d’Outre-mer, d’Afrique noire, des Caraïbes et de La Réunion. La France recrute de la main-d’œuvre directement via l’État, ou via les entreprises. L’État privilégie les DOM-TOM, en faisant venir en métropole des Antillais, des Réunionnais, des Guyanais et des Comoriens, destinant les hommes à l’armée et à la fonction publique, les femmes aux travaux domestiques ou à la santé (aides-soignantes). À partir de 1963, l’administration française, soucieuse d’apaiser les tensions sociales dans les DOM-TOM (chômage et autres problèmes structurels), favorise la venue de familles entières depuis ces territoires par le biais du BUMIDOM (Bureau pour le développement des migrations dans les départements d’outre-mer, actif jusqu’en 1983). Celui-ci enrôle des travailleurs peu qualifiés et les forme pour occuper des postes de la fonction publique au sein des PTT (Postes et Télécommunications) et de l’Assistance socio-médicale ou les encadre pour les travaux domestiques dans un centre spécialisé situé à Crouy-sur-Ourcq (77), surnommé « la Sorbonne du balai-brosse ».
Celui-ci enrôle des travailleurs peu qualifiés et les forme pour occuper des postes de la fonction publique au sein des PTT (Postes et Télécommunications) et de l’Assistance socio-médicale ou les encadre pour les travaux domestiques dans un centre spécialisé situé à Crouy-sur-Ourcq (77), surnommé « la Sorbonne du balai-brosse ».
De leur côté, les entreprises du BTP et de l’industrie manufacturière préfèrent recruter en Afrique, poussant l’État à signer des accords avec plusieurs pays (1962-1963 : Mauritanie, Sénégal, Mali ; 1966 : Côte d’Ivoire). En 1957, les travailleurs africains noirs sont près de 20 000, parmi lesquels 4 000 Malgaches ; le reste provenant quasi exclusivement de l’ancienne AOF. Si certains sont d’origine rurale (Maliens ou Sénégalais : Soninkés, Peuls, Diolas, Manjaks, Sérère, etc.), d’autres sont issus de milieux urbains et mieux scolarisés (Camerounais, Togolais, Ivoiriens, Béninois, Congolais, etc.).
L’État comme les personnes concernées opèrent une distinction nette entre les originaires des DOM-TOM et les Africains (avec les Malgaches), en établissant des structures d’accueil différenciées. En 1961, l’Association pour l’accueil des travailleurs africains et malgaches (AFTAM) est créée, ancêtre des foyers SONACOTRA, aujourd’hui devenus COALLIA.
Au milieu des années 1960, plus de 100 000 ressortissants des DOM-TOM sont présents en métropole, ce chiffre continuant d’augmenter, tandis que les Africains noirs sont estimés à quelque 40 000, donnée approximative compte tenu des personnes en situation irrégulière.
Ces ressortissants africains sont caractérisés par un important dynamisme associatif, ainsi que par un taux non négligeable de syndicalisation (Cf. l’UGTSF, Union générale des travailleurs sénégalais en France, 1961). L’opinion publique les stigmatise moins que les « Arabes », et ils organisent leur migration par des systèmes informels de financement (« tontines » ou cotisations entre membres d’un réseau social) et par la mise en place de « norias » migratoires, des allées et venues de personnes qui alimentent, selon un système de rotation périodique, les mêmes postes de travail en France.
Le tournant des années 1970
En 1972, les circulaires Marcellin-Fontanet lient les autorisations de séjour en France à la possession d’un contrat de travail et d’un « logement décent ». De nombreux Africains noirs finissent ainsi par alimenter les rangs des premiers sans-papiers.
La suspension officielle de l’immigration de travail, le 3 juillet 1974, touche particulièrement les immigrés « subsahariens », objet d’expulsions répétées.
Parallèlement, les régimes dictatoriaux qui s’installent à la tête des États africains, des Comores et d’Haïti, génèrent des flots de migrants forcés qui demandent l’asile dans l’Hexagone. Au cours des décennies 1970, 1980 et 1990, aux flux de ressortissants des anciennes colonies françaises s’ajoutent les Africains provenant d’autres pays francophones, comme le Zaïre, le Rwanda et le Burundi, anciennes possessions belges.
Le tournant de 1974 marque également la fin du modèle migratoire des « norias » africaines : le va-et-vient régulier entre pays d’origine et pays d’accueil cède la place à l’installation durable des familles immigrées. Leur « intégration », en principe favorisée par les liens historiques avec la France, se heurte à l’ethnicisation progressive de la société françaiseQK, avec ses résurgences populistes, ses stéréotypes et ses inégalités.
La création de la « forteresse Europe », manière imagée de définir l’Espace Schengen par rapport aux populations situées en dehors de ses frontières, frappe avant tout l’immigration africaine, au point qu’actuellement en Europe elle devient numériquement la moins importante tout en étant la plus médiatisée.
Mondialisation et diversification des provenances
Le phénomène dit de la « mondialisation », qui s’accélère à partir des années 1990, génère des flux migratoires qui dépendent de moins en moins des affinités historiques et culturelles entre les pays d’origine et d’accueil. Ceux qu’une certaine opinion publique qualifie encore de « Noirs » ou d’« Africains », constituent désormais un caléidoscope de populations aux multiples provenances, cultures, générations et religions. Bien que l’imaginaire collectif français associe souvent l’immigré africain noir à l’islam, beaucoup d’Africains sont chrétiens, animistes et, plus rarement, athées. Si certains d’entre eux font partie des nouveaux arrivants qui ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie, de plus en plus de personnes d’origine subsaharienne sont toutefois déjà à la retraite.
Lorsque les « banlieues sensibles » sont le théâtre d’émeutes ou de faits divers, un amalgame est fait entre les descendants des immigrés noirs et les descendants des immigrés maghrébins, même si les recherches dans ce domaine montrent que cela ne correspond pas à la réalité. Les enfants d’Africains noirs possèdent des références culturelles beaucoup plus diversifiées, puisqu’elles découlent de beaucoup plus de pays et de populations, et à parité de situation socioprofessionnelle entre familles « noires » et maghrébines, les deux groupes de population tendent à rester séparés, voire à se mettre parfois en concurrence.
De nos jours, parler d’immigration « noire » a de moins en moins de sens, l’éventail des cas de figure s’étant énormément élargi.








