



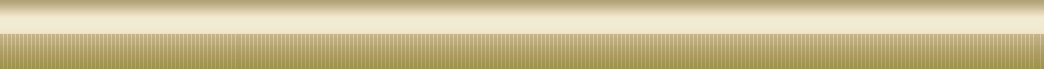


Genre et migrations
Les premières études sur les migrations humaines ont souvent considéré les migrants comme une « force de travail » étrangère appelée à répondre aux exigences du capitalisme des pays les plus développés, ce qui a eu pour conséquence de véhiculer deux idées qui ne correspondaient pas vraiment à la réalité : d’une part que les immigrés n’étaient destinés qu’à l’économie de production (autrement dit tous les secteurs d’activité dont le but est la production d’objets et de marchandises), et d’autre part, que les immigrés n’étaient quasi exclusivement que des hommes, faisant ainsi de la migration, implicitement, un phénomène typiquement masculin.
S’il est vrai que durant l’époque contemporaine la migration a, selon les périodes, plutôt concerné les hommes que les femmes, il faut en revanche souligner que les trajectoires des femmes migrantes ont fait l’objet de bien moins de recherches pour des raisons idéologiques et qu’aujourd’hui les femmes sont aussi nombreuses que les hommes à migrer et qu’elles se révèlent tout aussi indispensables pour l’économie des pays d’émigration que des pays d’immigration.
Les aspirations à l’égalité entre les sexes, à l’éducation et à l’indépendance que les femmes ont manifesté avec détermination dès la fin du XVIIIe siècle, puis la lutte que beaucoup d’entre elles ont menée pour atteindre ces objectifs, ont à la fois accru leur présence au sein de l’espace public et mis en exergue leurs apports et leurs spécificités dans tous les secteurs d’activité. Au niveau migratoire, cela s’est d’abord traduit par une reconnaissance de la présence féminine sur les routes de la mobilité humaine, puis par des recherches sur la signification du migrer au féminin et ses répercussions sociales. La femme migrante, parce qu’elle entre en contact avec d’autres univers socioculturels et parce qu’elle est souvent la seule à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, devient un facteur potentiel de transformation des sociétés où elle évolue.
Ceux, ou plutôt celles qui se sont penchées sur ces problématiques, ont préféré parler de « genre et migrations » plutôt que de « femmes en migration », bien que cette dernière expression revienne souvent dans leurs écrits. Les auteurs en question ont ainsi voulu souligner que les rôles joués par les femmes et par les hommes sont plus le fruit d’une « construction sociale » qu’une conséquence naturelle (ou, comme le dit en 1949 Simone de Beauvoir dans son livre Le deuxième sexe : « On ne naît pas femme, on le devient ») et que la migration féminine a comme conséquence principale une redéfinition des relations entre les sexes. « Comme les femmes ont été et sont encore, dans de nombreuses régions du monde, associées à l’immobilité et à la passivité, celles qui partent, plus souvent seules qu’avant, [...] sont, par l’acte même de migrer, susceptibles de bousculer l’ordre établi, et de subir la stigmatisation morale et ses effets » (Mirjana MorokvasicQK).
Les études qui ont observé le phénomène migratoire sous le prisme du « genre » ont apporté une nouvelle sensibilité, capable de faire émerger des aspects profonds relatifs aux motivations, aux perceptions et aux trajectoires individuelles des migrants. L’impact de la migration sur les familles et la vie personnelle des protagonistes est devenu plus manifeste, permettant de redimensionner les théories purement politiques ou économiques.
Dans les fiches du Migral qui vont suivre nous traiterons de l’émergence de la perspective du genre en lien avec les migrations, de sa pertinence dans l’analyse des phénomènes, du travail féminin et de ses répercussions tant au niveau des marchés du travail qu’auprès des sociétés, ainsi que des problématiques liées au mariage dans un contexte de mixité culturelle.









