



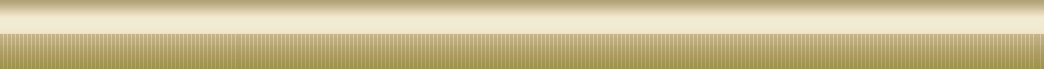

France : l’immigration sous la Troisième République

Le tournant de la Troisième République
En France, dans l’histoire de l’immigration contemporaine l’année 1870, qui correspond à la fin du Deuxième Empire et au début de la Troisième République, représente un véritable tournant pour plusieurs raisons.
Avant cette date, au milieu du XIXe siècle, malgré la mécanisation des transports et l’industrialisation qui progressent dans l’Hexagone, le pays n’attire pas encore un grand nombre de travailleurs étrangers. En 1851, lors du premier recensement, ces derniers, essentiellement des frontaliers (Belges, Italiens, Allemands, Suisses), sont à peine 300 000 sur une population de 34 millions d’habitants . Le grand pôle d’attraction est Paris, où convergent ouvriers, intellectuels et entrepreneurs. À cette époque, le mot « étranger », presque synonyme de « vagabond », s’applique plus aux Français qui migrent hors de leur village qu’aux ressortissants d’autres États. En 1860, un accord de libre circulation entre la France, la Belgique et l’Angleterre facilite l’implantation dans l’Hexagone d’entrepreneurs étrangers (Valentin Rawle, John Holker, William H. Waddington, etc.).
. Le grand pôle d’attraction est Paris, où convergent ouvriers, intellectuels et entrepreneurs. À cette époque, le mot « étranger », presque synonyme de « vagabond », s’applique plus aux Français qui migrent hors de leur village qu’aux ressortissants d’autres États. En 1860, un accord de libre circulation entre la France, la Belgique et l’Angleterre facilite l’implantation dans l’Hexagone d’entrepreneurs étrangers (Valentin Rawle, John Holker, William H. Waddington, etc.).
En 1870, en revanche, avec l’instauration de la Troisième République, la France passe symboliquement du statut de « puissance impériale » à celui de véritable « État-nation », où l’identité et l’unité nationales justifient l’existence de l’État, censé protéger, préserver et promouvoir ces valeurs. En 1878, le mot « immigration » apparaît ainsi pour la première fois dans un supplément du dictionnaire Larousse. Dans une France où une enquête réalisée en 1868 révèle que moins de la moitié des habitants parle français, les responsables politiques se doivent de donner aux citoyens un socle culturel commun. En 1891, un manuel scolaire intitulé Le Tour de France par deux enfants contribue à ce projet d’assimilation républicaine.
Dans le même temps, les flux migratoires internes et depuis l’étranger s’intensifient. La capitale attire de nombreux provinciaux, notamment des Auvergnats et des Bretons, rapidement victimes de stéréotypes (Cf. l’histoire de Becassine, la bonne bretonne de la revue La semaine de Suzette).
Parmi les étrangers, ce sont les Italiens qui font l’objet de la plupart des jugements négatifs de la part de l’opinion publique à la fin du XIXe siècle. Ils sont considérés comme sales, voleurs, profiteurs, intégristes et terroristes (Cf. les attentats de Felice Orsini contre Napoléon III en 1858 et de Santo Caserio contre le président Sadi Carnot en 1894). La xénophobie anti-italienne s’exprime parfois de manière sanglante, comme en août 1893 à Aigues-Mortes (Gard) : une rixe entre travailleurs français et italiens au sein de la Compagnie des Salins du Midi fait plusieurs morts et de nombreux blessés parmi les Transalpins.
Au cours des dernières années du siècle, la France se découvre non seulement italophobe, mais aussi antisémite ; en 1893-1894 éclate l’affaire Dreyfus, lors de laquelle des antidreyfusards tentent de faire du juif un non-national.
En 1889, mus par la faiblesse démographique du pays et face à la puissance militaire allemande, les parlementaires français votent le retour au jus soli ; Maxime Lecomte, qui présente le projet de loi, affirme devant les députés qu’« il est indispensable de limiter ce fait dangereux que depuis quatre-vingts ans des générations d’étrangers se succèdent sur notre territoire en conservant leur autonomie, en ayant pas les mêmes intérêts de défense nationale que les Français » (JO, Ch. dép., Déb. Parl., 16/03/1889).
Au fur et à mesure que la France met en œuvre une politique de grands travaux et que le patronat manifeste une nette préférence pour les immigrés, considérés comme plus malléables, meilleur marché et non syndicalisés, les premiers accords de main-d’œuvre sont mis en place avec l’Italie (1904) et la Belgique (1906).
La Première Guerre mondiale
En 1911, la France compte plus de 1,2 million d’étrangers. À l’approche du premier conflit mondial se pose alors la question des étrangers “ennemis potentiels” : Allemands, Austro-Hongrois, Turcs… et Alsaciens-Lorrains. Parmi ceux-ci, certains rentrent dans leurs pays, tandis que d’autres font le choix de la France (Légion étrangère).
Si en 1870 l’armée française avait déjà rappelé des colonies un contingent de tirailleurs sénégalais, entre 1914 et 1918, la présence des soldats coloniaux est plus importante .
.
La guerre accentue les besoins de bras pour soutenir l’agriculture et l’industrie . En 1915, Albert Thomas, responsable de l’Armement et des Fabrications de guerre (puis premier directeur du Bureau international du Travail), crée le Service de la main-d’œuvre étrangère (SMOE) et le Service des travailleurs coloniaux (STOC), organismes censés repérer et recruter des travailleurs étrangers européens, coloniaux ou coolies
. En 1915, Albert Thomas, responsable de l’Armement et des Fabrications de guerre (puis premier directeur du Bureau international du Travail), crée le Service de la main-d’œuvre étrangère (SMOE) et le Service des travailleurs coloniaux (STOC), organismes censés repérer et recruter des travailleurs étrangers européens, coloniaux ou coolies  (Cf. [#615]) ; c’est le point de départ d’une gestion étatique de l’immigration, qui génère un flux de 450 000 personnes.
(Cf. [#615]) ; c’est le point de départ d’une gestion étatique de l’immigration, qui génère un flux de 450 000 personnes.
L’immigration massive de l’entre-deux-guerres
En 1918, au sortir de la guerre, la France, exsangue, manque cruellement de main-d’œuvre. En matière d’immigration, alors que l’État prend peu d’initiatives, le patronat s’organise en créant des sociétés privées afin de recruter des travailleurs étrangers. L’effort pour attirer dans l’Hexagone des travailleurs polonais, italiens et tchécoslovaques, se concrétise par la signature de conventions bilatérales avec la Pologne en 1919, l’ Italie en 1919 et la Tchécoslovaquie en 1920. Les Polonais sont notamment recrutés par la Mission française de la Main-d’œuvre installée à Varsovie, à Czestochowa et à Poznan et arrivent au dépôt de Toul (Meurthe-et-Moselle), inauguré en 1919 dans les locaux d’une ancienne caserne, et utilisé comme pôle de contrôle sanitaire et de tri en vue de l’envoi vers les lieux de travail. À partir de 1924, les différents organismes de recrutement situés hors des frontières de l’Hexagone se fédérèrent autour de la Société Générale d'Immigration (SGI).
Entre 1921 et 1931 les immigrés voient leur nombre passer de 1,5 à 3 millions (soit 8% de la population), sans tenir compte des naturalisations (400 000, dont plus de 50% concernent des Italiens) favorisées par une loi de 1927. Même si les attitudes xénophobes (surtout à l’encontre des Polonais) se répandent, ces années voient la création du Service Social d’Aide aux Émigrants (SSAE) en 1921, dont l’objectif est de venir en aide aux étrangers devant surmonter des difficultés personnelles ou familiales.
les immigrés voient leur nombre passer de 1,5 à 3 millions (soit 8% de la population), sans tenir compte des naturalisations (400 000, dont plus de 50% concernent des Italiens) favorisées par une loi de 1927. Même si les attitudes xénophobes (surtout à l’encontre des Polonais) se répandent, ces années voient la création du Service Social d’Aide aux Émigrants (SSAE) en 1921, dont l’objectif est de venir en aide aux étrangers devant surmonter des difficultés personnelles ou familiales.
Dans les années 1930, la crise économique mondiale freine progressivement l’afflux d’immigrés en France , qui ne compte déjà plus que 2,3 millions d’étrangers en 1939. Après avoir accueilli de nombreux réfugiés espagnols (400 000 opposants à Franco traversent les Pyrénées-Orientales en 1936) et antifascistes italiens, en 1938 l’Hexagone promulgue les décrets-lois Daladier, qui facilitent les expulsions et créent des “camps de concentration” pour les étrangers considérés comme “indésirables” (clandestins, communistes, malades ou chômeurs).
, qui ne compte déjà plus que 2,3 millions d’étrangers en 1939. Après avoir accueilli de nombreux réfugiés espagnols (400 000 opposants à Franco traversent les Pyrénées-Orientales en 1936) et antifascistes italiens, en 1938 l’Hexagone promulgue les décrets-lois Daladier, qui facilitent les expulsions et créent des “camps de concentration” pour les étrangers considérés comme “indésirables” (clandestins, communistes, malades ou chômeurs).








